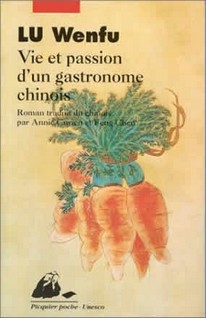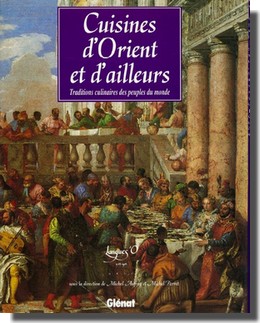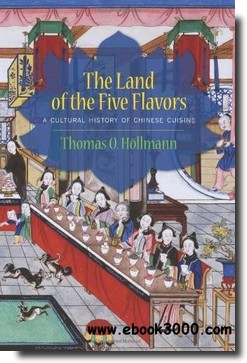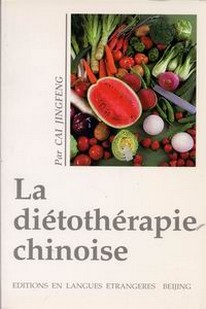巴黎北京美食




|
|
Les livres |
« Canard
laqué, Canard au sang : dialogue culturel entre les cuisines chinoise et
française », William Chan Tat Chuen
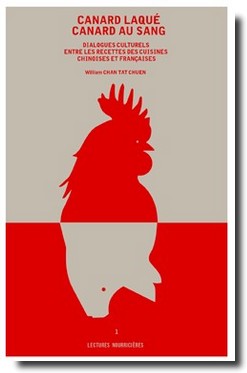 |
Après de nombreux ouvrages
consacrés à la culture chinoise et en particulier à la gastronomie, Fêtes et Banquets en Chine (1992), A la table de l’empereur de Chine (2002), A la table du rêve dans le Pavillon (2009), Le tofu, dix façons de le préparer (2011), William Chan Tat Chuen,
sinologue et spécialiste des cultures et rituels alimentaires, cuisinier
diplômé de l’école française de Thonon Les Bains et élève de
l’historien Jean Louis Flandrin, nous invite à travers son livre à
paraître aux éditions de l’Epure en mars 2016 « Canard
laqué, canard au sang : Dialogues
culturels entre les cuisines française et chinoise »
à découvrir et à partager sa passion conjointe des interfaces
culturelles des cuisines françaises et chinoises.
Son livre inaugure une nouvelle collection aux éditions de l’Epure
baptisée « Lectures
nourricières ». Voici la
présentation du livre :
|
« Au-delà de leurs différences
et de leurs spécificités culturelles, de leurs terroirs, ou encore de leurs
manières de table, existe-t-il des points de convergence entre les cuisines
françaises et chinoises, considérées comme parmi les meilleures du monde,
avec une histoire gastronomique riche de plusieurs siècles ?
A travers le prisme de 70 recettes étudiées
conjointement entre ces deux pays, on découvrira que les similitudes et les
ressemblances sont nombreuses. Elles se jouent sur les destins historiques et
parallèles des recettes emblématiques qui deviennent des icônes des
gastronomies des deux pays, comme le tandem canard laqué de Pékin et canard au
sang de Paris ; sur des recettes qui se rapprochent par les ingrédients et les
techniques utilisés comme les grenouilles sautées à l’ail et les crêpes ;
sur la même vision d’une cuisine qui soigne et qui fortifie le corps, comme
ce bouillon de poule ; sur des cuisines qui utilisent joyeusement l’alcool
comme principe d’assaisonnement avec le coq au vin jaune du Jura et le coq
ivre à l’alcool de Shaoxing ; sur des cuisines capables d’incorporer des
ingrédients culinaires venus du nouveau monde comme la pomme de terre et la
tomate grâce à la force de leur grammaire culinaire ! ».
Ces
points de convergence, révélés par le « dialogue culturel» de ces 70
recettes est avant tout un joli prétexte pour voyager dans les cuisines de ces
deux pays que sont la France et la Chine, afin de mieux comprendre leurs
pratiques alimentaires, leurs techniques culinaires, leurs canons esthétiques
et leurs représentations symboliques.
Pour être informé de la
parution de « Canard
laqué, Canard au sang : dialogue culturel entre les cuisines
chinoise et française » de William Chan Tat Chuen, et le recevoir
en avant-première,
cliquez-ici.
Vous pouvez le rencontrer au salon du livre de Paris en mars 2016 avec les
animations autour de ce livre.
Pour fêter le nouvel an chinois, l'année du Tigre le 14 février 2010, Vous êtes invités à la table du "Rêve dans le Pavillon Rouge"
 |
En Chine, un proverbe dit que le peuple considère la
nourriture comme le Ciel. Dans cette riche famille Jia où les besoins
primaires étaient plus que satisfaits, où le Ciel s’était banalisé,
tous les membres avaient développé une philosophie du boire et du manger
sous l’angle du divertissement. Cette recherche du plaisir se décline
aussi bien dans les repas du quotidien que des fêtes. En vous invitant à
la table de cette famille aristocratique d’origine mandchoue sous le règne
de l’empereur Qianlong, contemporain de Louis XIV, vous découvrez la
gastronomie chinoise du XVIIIème siècle à travers les mets et boissons
évoqués par Cao Xueqin
dans son roman « Le rêve dans
le Pavillon Rouge
».
|
Vous serez séduits par les saveurs exquises des mets, par la découverte d’ingrédients nouveaux, par la délicatesse des thés et des alcools servis, par les méthodes de prévention de santé par la nourriture, par la complexité de l’étiquette et des rituels de table liée au statut des mangeurs. Pour les mets seulement évoqués dans le roman, les recettes interprétées par les plus grands chefs chinois vous sont proposés.
Pour les cuisiniers, les amoureux de l’histoire de la cuisine, c’est une véritable encyclopédie des pratiques de cette époque. Aucun autre roman chinois n’a donné de détails aussi précis dans l’approche de diétothérapie, dans l’organisation des menus quotidiens, des nourritures de saison, des banquets de fêtes. La nourriture, en tant que rituel social, symbolique, de saison ou expression d’une affectivité est largement développée tout au long de ce livre à travers les péripéties du roman.
Vous constaterez également la sinisation des habitudes alimentaires de la famille Jia, où comment le conquérant mandchou s’était laissé séduire peu à peu par le raffinement de la cuisine du dominé !
|
« Fêtes et Banquets en Chine », William CHAN TAT CHUEN, éditions Philippe Picquier. |
« A la table de l’empereur de Chine », William CHAN TAT CHUEN, éditions Philippe Picquier. |
« Vie et passion d’un gastronome chinois » LU Wenfu, éditions Philippe Picquier. |
||
|
|
|
|
||
| Nourriture de fête, plats traditionnels, cuisine des quatre saisons, petite histoire des habitudes alimentaires en Chine, légendes, recettes de banquet. Ce livre est tout cela à la fois : en même temps que l'occasion d'un voyage passionnant à la découverte de la cuisine chinoise. |
|
Franchissant
les hauts murs de la Cité Interdite, le lecteur pénètre dans le secret
des offices où des cuisiniers venus des quatre coins de l'Empire
élaborent les plats préférés de l'empereur Qianlong. Accompagnant
eunuques et dames de cour, il parvient jusqu'à la table impériale, où
une étiquette minutieuse régente chaque détail. Il pourra aussi, s'il
le désire, expérimenter les recettes soigneusement choisies et
conservées qui faisaient les délices de l'empereur et de sa cour.
|
Ce roman se déguste une serviette autour du cou. Ce sont quarante années de vie chinoise autour de la table qui sont évoquées ici, témoignant de la survie des traditions culinaires envers et contre toutes les turbulences en Chine. Vous ne cesserez d'être tenu en haleine par la véritable héroïne du roman : la gastronomie. | |
La Pastèque, la Papaye, le tofu, William Chan Tat Chuen, éditions de l'Epure
 |
Dans cette collection "Dix façons de la
préparer" des Editions de l'Epure, vous avez une liste de produits
impressionnants, du plus simple au plus sophistiqué, proposé en dix
recettes par des chefs, des spécialistes du produit, des sociologues, des
journalistes spécialisés, des passionnés de la cuisine...Une visite sur
le site de l'édition s'impose.
La pastèque adorée par les français est aussi le fruit le plus emblématique de l'été à Pékin. La papaye, plus exotique pour les français, est un ingrédient culinaire qui fait parti du quotidien des chinois pour ses bienfaits de dietothérapie et pour son goût. Le tofu est une création chinoise : c'est la protéine végétale la plus consommée de Chine. |
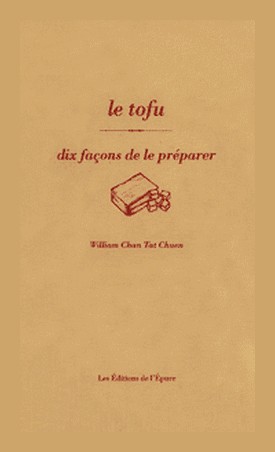  
|
|
« Food in Chinaese Culture », CHANG KC, Yale University Press. |
"The food in China", ANDERSON, |
«Cuisines d'orient et l'Ailleurs », éditions Glénat |
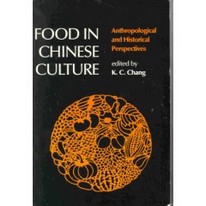 |
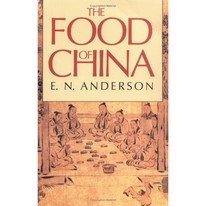 |
|
|
"Pékin aux éditions Riverboom" |
The
land of the five flavors : a cultural history of Chinese cuisine de Thomas
O Höllmann, Columbia University
|
« La diétothérapie chinoise », CAI JingFeng, éditions des langues étrangères Pékin. |
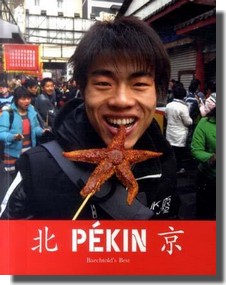 |
|
|
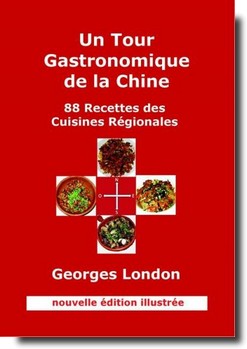 |
Un
tour gastronomique de la Chine : 88 recettes des cuisines régionales de Georges London, édition
GWLondon-press.
|
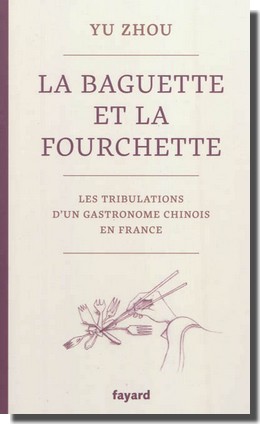 |
La
baguette et la fourchette « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà »
disait Montaigne. Cette citation s’applique sur les pratiques alimentaires de
chaque pays. Pourquoi ce qui est jugé fade par les français est ressenti comme
si délicieuse en Chine ? Pourquoi un français se permet-il de sucrer une
tasse de thé « Puits du Dragon », un thé extrêmement délicat et
précieux en Chine alors qu’il s’offusque à la vue des chinois qui coupent
un grand vin bordelais avec du soda, juste pour atténuer l’amertume ?
Dans son livre « La baguette et la
fourchette » aux éditions Fayard, Yu Zhou, éprise de littérature
française, professeur de langue et civilisation chinoise joue le rôle
d’interface culturelle pour éclairer à la fois les pratiques de table aussi
bien françaises que chinoise, à travers son histoire personnel . Pendant son
enfance en Chine, il a rêvé de grandes cuisines et de plats raffinés, des rêves
épicuriens inappropriés dans
|
Arrivé à Nantes en 1999 pour parfaire ses connaissances en littérature française, il décide de découvrir cette gastronomie qui lui faisait tant rêver en rencontrant des grands chefs français. Il dépensait les maigres économies gagnés ici et là pour déguster certaines grandes tables. Même s’il se déclare ouvert aux goûts français parce qu’il consomme du fromage, il reste attaché à sa cuisine d’origine. Dans un chapitre du livre, en dégustant un grand ravioli d’un chef connu, plat inspiré suite au voyage en Chine de ce dernier, on sent que Yu Zhou préfère la version chinoise. D’ailleurs, il décrit que le mécanisme de la saveur d’un sandwich est le même que celui d’un ravioli : « quand on croque un sandwich français, on a d’abord une succession de sensations liées aux différentes textures : le pain croustillant, la mie moelleuse, les crudités juteuses, le jambon tendre et enfin le fromage onctueux. En même temps, c’est aussi une succession de parfums excitant nos papilles : ceux du blé légèrement brûlé, des crudités, du fromage et de la viande. Sous l’effet de la mastication, toutes ces textures et tous ces parfums se mélangent et créent ainsi une sorte de kaléidoscope pour la bouche et le nez. ». Lors de la dégustation d’un ravioli chinois « Quand les dents coupent le ravioli, outre la succession et le mélange de sensations de textures et de saveurs comme on la trouve dans le sandwich, on a de plus une explosion de goûts et de parfums, un jaillissement de jus, tout cela est propulsé par la chaleur et l’air enfermés à l’intérieur du ravioli (contrairement au sandwich). Une caméra à haute vitesse et à infra-rouges le montrerait ». Pourquoi Yu Zhou n’avait pas été séduit par le ravioli du chef ? Cela vient de sa taille. Pour ressentir les plaisirs gustatifs identiques à ceux d’un sandwich, le ravioli doit se manger en une bouchée !
Qu’est-ce qui lui a plus étonné dans la cuisine française ? Même s’il a débuté ses repas dans les restaurants universitaires, c’est la séparation des ingrédients, des légumes et des viandes, qui l’a le plus étonné. Sur son regard chinois, les ingrédients cuisinés ensemble sont meilleurs que lorsqu’ils sont traités séparément. Sur l’approche des goûts, à travers l’exemple du doufu (fromage de soja), il fait l’éloge de la fadeur, qui permet d’apprécier à leur juste valeur les nuances les plus subtiles et les plus variés, illustré aussi avec des exemples en lien avec la musique, la peinture. De même, on observant les farces et garnitures plutôt cachés dans une pâte en Chine et exposées au grand jour en France telle les pizzas, les quiches, il met en avant un des traits de la culture chinoise, suggérer plutôt qu’étaler. Cette notion de ce qui est caché-révélé régissent aussi les règles de politesse et de partage des chinois.
Dans un des chapitres du début du livre, en découvrant un « très vieux » cahier de recette de sa mère qui date des années 1970, où aucune instruction n’était donnée en termes des quantités des ingrédients, Yu Zhou nous explique que la cuisine chinoise se transmet oralement, de génération en génération. A travers une érudition parfaite, des échos à des histoires et faits historiques, il nous explique que derrière chaque mets, il y a toujours du goût, du sens, du symbole.
"Si
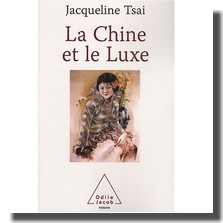 |
« La Chine et le luxe », Jacqueline Tsai, édition Odile Jacob. Pourquoi le jade incarne-t-il le luxe éternel pour les Chinois ? Que révèle l'art de vivre du lettré ? Qu'évoquent les « pieds bandés » ? Que dévoilent la robe fendue et les talons hauts de la Shanghaienne des années 1930 ? Comment expliquer le succès des grands centres commerciaux à Hong Kong dans les années 1980-1990 et désormais à Shanghai ? Que préfigurent le renouveau des maisons de thé à l'ancienne, le ré-enchantement de l'âge d'or de Shanghai ou l'intérêt pour les antiquités chinoises ? À travers ces exemples phares, c'est la société chinoise dans son évolution et ses tendances qui est explorée par Jacqueline Tsai dans son intervention.
|
Loin d'être superflus, les enjeux du luxe concernent le rayonnement de la Chine, l'identité de la nation : les goûts trahissent des ambitions ou penchants politiques y compris dans l’alimentation et l’art de la table. Après la vision d'une armée vêtue d'uniformes bleus tenant le petit livre rouge puis celle de « l'usine du monde », la Chine est désormais considérée comme l'eldorado des produits de luxe. Ne se limitant pas au statut de ville phare consommatrice du luxe, Shanghai et Pékin ont la volonté de se poser comme émetteur de tendances et de culture. Bien moins visible et médiatisée, cette nouvelle conquête a déjà commencé. L'orientalisation croissante des formes de consommation en Occident n'en est-t-elle pas le signe ? Ou encore, que révèlent l'attrait pour le cinéma chinois et l'engouement récent pour l'art contemporain chinois ?
Depuis plus de 10 ans, Jacqueline Tsai analyse les évolutions socio-économiques et culturelles de la Chine. Travaillant dans le groupe LVMH, leader mondial du luxe, son activité professionnelle l'a amenée à analyser en particulier le développement du marché du luxe.